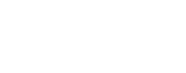Une « Déclaration de conscience animale »
Le 7 juillet 2012, un groupe international de scientifiques de renom et de chercheurs en sciences cognitives, neuropharmacologistes, neurophysiologistes, neuroanatomistes et neuroscientifiques signait la Déclaration de Cambridge sur la Conscience animale. Proclamant ainsi officiellement leur soutien à l’idée que les animaux ont une conscience.
Un minuscule pas dans la reconnaissance de l’animal, de ce qu’il vit et de ce qu’il représente.
Il aura fallu de très longues années pour que le monde scientifique admette, par des preuves, que les êtres humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques qui produisent la conscience. De là à ce que nos dirigeants et chaque être humain puissent entendre le bruissement de la voix de la cause animale, il reste malheureusement un abîme.
Extraits de la déclaration :
« L’absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d’éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que les animaux non-humains possèdent les substrats neuro-anatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non-humains, notamment l’ensemble des mammifères et des oiseaux ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. »
Les grands singes par exemple, mais aussi les dauphins, les cochons, les éléphants et même les pies se reconnaissent dans un miroir. Un test classique de la conscience de soi utilisé depuis de longues années et que les enfants ne réussissent pas avant 18 mois…
L’abondance de nouvelles techniques et stratégies de recherche sur les hommes et les animaux nous donnent davantage de données, exigeant une réévaluation périodique des idées préconçues. A titre d’exemple, l’excitation artificielle des mêmes régions du cerveau génère un comportement et des états affectifs similaires chez les humains et les animaux.
Dépourvus de néocortex, les enfants et les jeunes animaux fonctionnent avec leur cerveau sensoriel et le cortex. Ils conservent toutes les fonctions du cerveau-esprit.
Chez les mammifères et les oiseaux, les réseaux affectifs et cognitifs sont beaucoup plus développés que ce que les chercheurs pensaient. Les interventions pharmacologiques avec des composés connus pour affecter le comportement conscient chez les humains peuvent conduire à des perturbations similaires dans le comportement des animaux...
La déclaration de Cambridge sur la conscience a été écrite par Philip Low et édité par Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low et Christof Koch.
Changer le rapport de l’homme à l’animal
« Il n’y a pas de différence fondamentale entre l’homme et les mammifères supérieurs sur le plan des facultés mentales (…) la différence intellectuelle entre l’Homme et les animaux, si grande soit-elle, n’est qu’une question de degré et non de genre. » déclarait déjà, en son temps, Charles Darwin. Il aura fallu attendre le XXIe siècle pour que les scientifiques donnent raison au Grand homme. Et le prouvent, avec les dernières études sur la « sentience », cette capacité de percevoir et de ressentir des émotions et, par conséquent, d’avoir des désirs, des buts, une volonté qui leur sont propres.
Il est aujourd’hui reconnu par tous que les animaux sont des êtres sensibles, à un degré plus ou moins élevé. Un animal éprouve un ensemble de sentiments (sensations, perceptions et émotions) positifs ou négatifs, depuis la douleur et la peur jusqu’au plaisir et la joie. Des études scientifiques ont d’ailleurs montré que certains animaux présentaient un type de capacités mentales de haut niveau que l’on croyait, jusqu’alors, réservées aux seuls humains comme être conscients d’eux-mêmes, être capables de résoudre des problèmes nouveaux, avoir des représentations mentales ou encore comprendre ce que d’autres animaux savent ou se disposent à faire.
Depuis 1997, l’Union européenne reconnaît les animaux comme des « êtres sensibles ». Ainsi, le droit européen oblige les Etats membres à « tenir pleinement compte des exigences en matière de bien-être animal. » Cependant, les découvertes de ces dernières années en matière de « sentience » posent véritablement une autre question, essentielle : celle du rapport de l’homme à l’animal.
La science découvre sans cesse de nouvelles informations sur la capacité des animaux à ressentir, éprouver, penser. Alors, si les animaux sont conscients de ce qu’ils ressentent, s’ils savent où ils sont, avec qui ils sont, comment l’homme peut-il continuer à les traiter comme des objets, à s’en servir comme de jouets ou de souffre-douleur, à les exploiter, les enfermer, les martyriser, les maltraiter ?
Source : « One voice »